Qualification de la conduction :

On chauffe la barre métallique à son extrémité. Cette chaleur est conduite tout le long de la barre métallique. L’expérience montre que le débit de chaleur est proportionnel à la différence de température entre les deux côtés de la plaque. Cette différence de température dépend aussi de la nature des matériaux qui conduisent la chaleur et ils sont caractérisés par leur conductivité thermique.
La grandeur qui détermine l’aptitude d’une substance à transmettre la chaleur est appelée conductivité thermique (\( \lambda \)) exprimée en \( W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1} \), qui dépend de la structure atomique de la substance.
Les métaux ont une conductivité thermique environ 400 fois plus grande que celle des autres solides, ceux-ci conduisent mieux que la plupart des liquides, enfin ces derniers la conduisent 10 fois mieux que les gaz (cf tableau ci-dessous).

Quand vous vous réveillez un matin froid et ne marchez pas sur le tapis, mais sur le carrelage, les pieds nus, vous comprenez alors ce que veut dire la conductivité thermique. Le carrelage et le tapis sont à la même température, car ils ont été toute la nuit en équilibre thermique. Mais vous avez l’impression que le carrelage est plus froid que le tapis. Le carrelage a une conductivité thermique environ 10 fois plus grande que celle du tapis et il ôte 10 fois plus de chaleur de vos pieds, qui sont à température plus élevée. C’est cette perte de chaleur que vous sentez comme « froideur » et non la différence de température ; en fait, nous ne sommes pas de bons thermomètres.
La propagation de la chaleur par conduction à l’intérieur d’un corps s’effectue suivant deux mécanismes distincts : une transmission par les vibrations des atomes ou molécules et une transmission par les électrons libres.
Généralement, un bon conducteur de la chaleur est aussi un bon conducteur de l’électricité ; ce n’est pas une coïncidence. Un métal peut être considéré comme un réseau cristallin d’ions positifs immergés dans une mer d’électrons essentiellement libres. La chaleur et l’électricité sont, toutes deux, principalement transportés par le mouvement de ces électrons libres, qui se comporte comme un fluide très mobile dans le métal.
Dans les mauvais conducteurs d’électricité, le transport de chaleur se fait principalement par le mode plus lent de collision moléculaire.
Manip Lycée Montaigne de Bordeaux: conduction de la chaleur (métaux) par Kaloucito (1'10") https://www.youtube.com/watch?v=h0dgQRN9qeo
Conduction thermique (partie 1) Quentin Delescluse (5'19") https://www.youtube.com/watch?v=suuhKLLZ_-k
Conduction thermique (partie 2) Quentin Delescluse (8'59") https://www.youtube.com/watch?v=0kcJLhNfTl0
Exemples de coefficients de conduction
| matériau | \( \lambda \, (W.m^{-1}.K^{-1}) \) |
| polyuréthane | 0,028 |
| Briques | 0,5 |
| Verre | 1 |
| Pierre | 2 |
| Acier | 45 |
| Aluminium | 203 |
Quantification de la conduction : Loi de Fourier
Si on se limite au régime stationnaire (les températures d’entrée et de sortie ne changent pas) et si le matériau de l’échantillon est homogène, la puissance thermique est inversement proportionnelle à l’épaisseur de la pièce.
Cette loi est connue sous le nom de Loi de conduction de Fourier.
Pour une différence \( \Delta T \) donnée, plus l’épaisseur L est grande, plus \( P_T \) est faible. Plus vos vêtements sont épais par temps froid, plus le taux de perte de chaleur est bas.
La théorie de la conduction repose sur l’hypothèse de Fourier : la densité de flux est proportionnelle au gradient de température :
\( \vec \phi = - \lambda \overrightarrow {grad T} \) en \( W.m^{-2} \)
Ou sous forme algébrique : \( \varphi = - \lambda S{{\partial T} \over {\partial x}} \approx - \lambda S{{d T} \over {d x}} \) en (W) et avec \( \lambda \) en \( W.K^{-1}.m^{-1} \)
ou plus simplement dans le cas considéré ci-dessous la puissance transitant à travers la surface S vaut:
| \( \phi = - \lambda {{T_2 -T_1} \over {x_2 -x_1}} \) en W/m² |
et
| \( \varphi = - \lambda S {{T_2 -T_1} \over {x_2 -x_1}} \) en W |
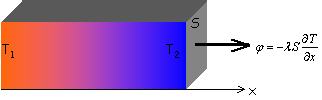
Résistance thermique
Dans la loi de Fourier, il est possible de rassembler les termes qui ne dépendant que des matériaux pour faire apparaître la notion de résistance thermique.
Exemple
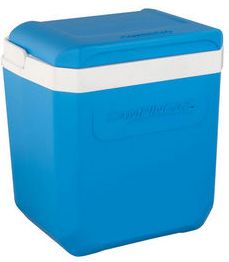
Une glacière de dimensions:
- 50x30x30 cm
- épaisseur de polyuréthane : 5 cm \( \lambda = 0,028 \)
- \( T_{ext}= 30°C \)
- \( T_{int}= 0°C \)
- contenant 1 L d'eau à 0°C
- Quel est le flux par m² ?
- Quel est le flux total ?
- A quelle vitesse monte la température au début ?
- Le flux par m² est de \( \phi = - \lambda {{T_2 -T_1} \over {x_2 -x_1}} = - 0,028 {{30 - 0} \over {0,05}} = - 16,8 W/m² \)
- Le flux total est de \( \varphi = S \times \phi = (4 \times (0,3 \times 0,5) + 2 \times (0,3 \times 0,3)) \times (-16,8) = 0,78 \times (-16,8) = - 13,1 W \)
Le flux de chaleur est négatif car le flux de chaleur rentre dans la glacière
- \( {{\Delta Q} \over {\Delta t}} = m C {{\Delta T} \over {\Delta t}} \)
donc \( P = m C {{\Delta T} \over {\Delta t}} \) donc \( {{\Delta T} \over {\Delta t}} = {{P} \over {m C}} = {{13,1} \over {1 \times 4185}} = 0,0031 °C/s \) mais cette valeur va changer au cours du temps!!!





